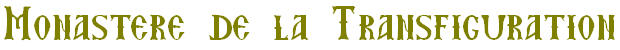La prison de la santé
Nommons-le Pierre : tôt le matin, le voilà qui s’affuble d’un masque, bien que ce ne soit pas carnaval. Pierre se hâte de faire ses emplettes à potron-minet, en un marché rendu célèbre par Georges Brassens, avant que la chaleur du mois d’août ne devienne suffocante, avant que l’affligeant spectacle d’une théorie de bipèdes grimés en égrotants ne lui refile le virus … de la mélancolie ! Pierre se dépêche. Mais une file d’attente s’est déjà formée devant un chaland réputé. Les quidams auxquels il s’agrège patientent, non sans quelque servilité. Notre homme, quelque peu frotté de philosophie, les regarde, autant que faire se peut, au travers de ses lunettes embuées et se dit, in petto, que les français sont, cette fois, effectivement tous devenus cartésiens, quoique de façon inattendue : ils font leur la devise de l’auteur d’un célèbre Discours : larvatus prodeo, je m’avance masqué ! Las ! Voilà qu’un intrus sans masque rejoint la file. Ah, l’horrible gaulois ! Des invectives fusent ! Une dame, mollement accorte, le gourmande avec arrogance, et stigmatise avec force décibels l’irresponsabilité et l’égoïsme assassin d’un tel insolent ! « L’enfer, c’est les autres », vaticinait le triste Sartre il y a un demi-siècle… son aphorisme fallacieux acquerrait-il désormais quelque véracité ? Désireux d’exorciser une sinistrose rampante, agacé par la pléthore de placards qui, en leur arrogante banalité, vantent les vertus salvifiques des masques et des distances, notre homme se carapate chez lui, presque apaisé par la perspective de se laisser réconforter par l’écoute purificatrice de quelque belle musique distillée par sa station préférée. Encore devra-t-il éviter de tomber sur un de ces étonnants « messages » concoctés par quelques drôles de la Santé Publique, proclamant que nous aimerons bien mieux notre grand-mère en ne l’approchant pas, que la fête familiale sera autrement joyeuse en étant délestée du moindre bisou et de la moindre esquisse de câlin. Orwell, vous connaissez ?
Laissons Pierre à ses déconvenues. J’entends déjà les désapprobations de tel ou tel lecteur : mais enfin, cher scribouillard, ignoreriez-vous que ce Covid 19 est une maladie dont on peut mourir ? Que beaucoup trépassent en étouffant ? Que le coronavirus semble susceptible d’altérer, chez ceux qui en ont réchappé, les fonctions cardiaques, pulmonaires ou cérébrales ? Non, cher lecteur, je ne l’ignore ni ne le nie. J’ai bien en tête qu’à ce jour, 30 000 décès sont imputables, en France, au coronavirus. Mais les chiffres doivent toujours être interprétés, d’abord parce que nombre de ces décès concernent des personnes âgées, ou malades, ou les deux à la fois ; autrement dit, le virus fut cet agent de trop portant un coup fatal à des organismes déjà fort délités. Nous ne sommes pas en présence de ces épidémies terrifiantes décimant une population en quelques semaines, tous âges confondus. Le virus auquel nous sommes confrontés n’est souvent, jusqu’à ce jour, qu’une cause occasionnelle de décès. Ensuite, ces mêmes chiffres doivent être comparés à d’autres données statistiques, ne serait-ce que celles des morts liées à une grippe saisonnière « ordinaire » affectant tout de même, en France et par année, 12 000 personnes, ou celles des cancers responsables de 150 000 décès par an, dans notre pays. Aurai-je le mauvais goût de rappeler que le nombre d’avortements pratiqués en France chaque année est supérieur à 200 000 ? (Chiffres de l’INED)
Certes, ni les avortements ni les cancers ne sont contagieux. Il reste que la disproportion entre les effets de l’épidémie et les conséquences des décisions prises pour l’enrayer ne peut que laisser perplexe quiconque accepte de réfléchir sans se laisser circonvenir par ses peurs, leur mise en scène médiatique ou son propre imaginaire. La philosophie stoïcienne invitait ses adeptes à toujours distinguer les « choses » les « événements » et la représentation que je m’en fais, car mon mal-être, disaient ces adeptes du Portique, procède davantage de mes représentations que du réel auquel elles se réfèrent. Si, au motif que la carrosserie de ma voiture a été éraflée, j’impose à tout un chacun un faciès furibard, épanchant ma bile du matin jusqu’au soir, il apert en effet que mon cinéma intérieur, plus que la tôle froissée, constitue la source véritable de mon irascibilité. Or, ce que nous avons eu à vivre depuis le 17 mars 2020, premier jour de « confinement » renvoie bien davantage aux représentations induites par l’épidémie qu’aux effets réels de cette dernière. Précisons tout de même : les effets professionnels, scolaires, familiaux de la législation liée à une situation dite « d’urgence sanitaire » ne relèvent pas de l’imagination d’un chacun, mais de décisions politiques dans lesquelles, certes, l’imaginaire n’est pas absent ; c’est cela qu’il convient d’examiner à présent.
Mis en scène avec complaisance par le gouvernement, un spectacle du « scientifique » s’est proposé de scander, au long de plusieurs semaines, le quotidien des téléspectateurs confinés. Un imaginaire à plusieurs niveaux. D’abord, celui de la gestion scientifique. Celui-là est ancré dans la confusion, qu’elle soit réellement crue ou seulement feinte, entre le politique et le savoir, entre l’action et, disons, la gestion. En effet, le domaine propre du politique est, par essence, celui de l’action : la racine latine de ce terme évoque une mise en mouvement. Agir, c’est mettre en mouvement des hommes. Il n’est pas certain que le politique y parvienne, et moins encore que ceux auxquels le pouvoir s’adresse se meuvent comme il le souhaiterait. L’action, porte sur des hommes, lesquels restent toujours caractérisés par de l’imprévisibilité : action et imprévisibilité restent indissociables. Outre celui de l’action, le domaine propre du politique est encore celui de la décision, laquelle est irréductible à un savoir : une décision fait toujours face à une situation complexe, instable et urgente, tandis que l’élaboration d’un savoir suppose une capacité d’analyse, le repérage de relations constantes, toutes choses qui demandent du temps, plusieurs années. Les qualités de l’homme d’action se nomment discernement, fermeté, courage, aptitude à entrainer et à persuader. Le tempo de l’action n’est donc évidemment pas le même que celui des laboratoires et des sciences ! Certes, un homme d’Etat peut s’entourer de savants, mais sa décision demeurera politique, donc de l’ordre d’un pari, éventuellement réfléchi ; elle ne pourra jamais dériver d’une science, elle devra le plus souvent se contenter de discerner le moindre mal, sans certitude d’y être parvenu.
Outre cet imaginaire de la « gestion scientifique », un second degré d’illusion est advenu grâce à l’institution, le 10 mars, du « Conseil Scientifique Covid 19 ». L’imaginaire ne provient pas, ici, des personnes le composant, et dont les compétences en épidémiologie sont, pour nombre d’entre elles, reconnues, mais plutôt de ceux qui ont institué un tel conseil, en escomptant évidemment quelque bénéfice politique consécutif à une telle création administrative. Or, ce bénéfice ne peut advenir que si le comité est suffisamment souple et habile pour répondre non à attentes véritablement scientifiques, mais à des représentations scientistes, faisant du savoir un pourvoyeur de certitudes stables sur lesquelles on puisse faire fond en toute confiance. Et c’est cela, justement que le dit Conseil scientifique ne peut fournir. En effet, le coronavirus concerné ne s’étant manifesté que très récemment, les scientifiques ne peuvent qu’élaborer un savoir à partir d’une multiplicité d’études sur ses modalités de diffusion, de contamination : cela requiert un croisement de données fiables, méthodiquement établies et croisées, cela requiert du temps. Ce sera dans un ou deux ans, voire davantage, que des hypothèses vérifiées et qui n’auront pas été invalidées par d’autres travaux prendront rang d’affirmations scientifiques. Or, le Pouvoir voudrait des réponses hic et nunc ! Redisons-le une fois encore : la temporalité de l’action ne peut pas être à l’unisson de celle du savoir !
Néanmoins, ce Conseil, mais surtout la mise en scène politico-médiatique dont il fit l’objet, avec cette grand-messe quotidienne nous racontant l’avancée du mal avec force sigles et chiffres supposés « faire scientifique » a tenu lieu de journal des opérations en temps de guerre ! L’infantilisation, induite de façon inévitable par ce genre de cérémonie, lui a emboîté le pas : « Attention ! Si vous ne faites pas ceci ou cela – avec des injonctions variables au fil des jours – vous serez punis – pardon, confinés – plus longtemps ! » Les chiffres du jour avec lesquels on nous rebattit les oreilles firent office de jugement jupitérien, lequel tantôt justifiait un durcissement des peines, tantôt faisait miroiter quelque élargissement… A cette sacralité du chiffre s’adjoignit la magie du jargon, avec -par exemple- ce terme de cluster qui sonne tout de même autrement savant que l’expression banale et claire de foyer épidémiologique ! En regardant, de temps à autre, ce spectacle offert par nos doctes grâce à la munificence des grands du jour, je ne pouvais m’empêcher de songer à ce qu’écrivait Emile Durkheim il y a plus de cent ans dans Les formes élémentaires de la vie religieuse : « La valeur que nous attribuons à la science dépend (…) de l’idée que nous nous faisons collectivement de sa nature et de son rôle dans la vie. (…) c’est qu’en effet tout dans la vie sociale, la science elle-même, repose sur l’opinion »
L’auteur ne dit pas que le contenu des sciences repose sur l’opinion, ce qui serait absurde, mais que la recevabilité de ce contenu est fonction de l’opinion. Et c’est bien pour cela que ces grandes liturgies sont loin d’avoir pleinement eu l’effet escompté : la parole des scientifiques n’est certes pas frappée du même discrédit que celle des politiques, mais elle ne fait plus non plus, ipso facto, autorité. Je n’éprouve, en ce qui me concerne qu’allergie et malaise, devant la montée des incompétences crasses et ignares qui, au nom d’une soi-disant liberté de pensée assènent via quelques « réseaux sociaux » (sic) la fatuité de leurs élucubrations. Néanmoins, comment ne pas comprendre l’attitude goguenarde avec laquelle nombre d’informations médicales et pharmaceutiques, en particulier, sont désormais, à tort ou à raison, reçues ? Le lobbying pharmaceutique joint à la pleutrerie ordinaire de tant de politiques en sont la cause : scandale du médiator, scandale du distilbène, dramatisation outrancière du virus H1N1 en 2009, obligation, depuis le 1er janvier 2018, d’injecter 11 vaccins contre trois auparavant, parce que ces trois ne rapportaient plus un kopek aux laboratoires … toutes ces impostures ou ces abus de pouvoir ont été accompagnés à chaque fois d’un argumentaire cynique et mensonger concocté sur des prémisses censées scientifiques… et tout cela a laissé des séquelles dans les esprits aussi !
Essayons d’approfondir notre réflexion, en revenant un moment à cette distinction stoïcienne évoquée plus haut entre les événements et la représentation de ces événements. Pour ce faire, rappelons qu’entre 98 et 99 % des personnes atteintes de la Covid 19 en réchappent. L’incidence des décès dus à cette maladie sur les statistiques de la mortalité ne semble pas, à ce jour, devoir être supérieure à la grippe asiatique de 1959 ou à celle de Hong-Kong de 1969. C’est grave, ce n’est non plus la peste et le choléra. Dans le département de la Dordogne, à la date du 11 août 2020, 14 décès ont été imputés au Covid 19, 37 en Corrèze, 1 … en Lozère. Encore faudrait-il connaître l’âge et les pathologies de chacune de ces personnes. La ville de Paris a enregistré 1790 morts, soit 0,08 % des habitants, même taux pour le département de la Moselle, avec ses 847 décès. Voilà pour quelques-unes des « données » cliniques et démographiques. Or, tout autres sont les effets sociaux qui ont affecté et affectent toujours l’ensemble de la population, du territoire. Ces effets sociaux ne sont pas dus à la Covid 19, mais à la représentation que ceux qui nous gouvernent s’en sont faite. Ainsi, en Lozère et en Dordogne aussi, comme à Paris, comme en Moselle, tous les commerces ont été fermés et nombre d’entre eux ne rouvriront jamais, toutes les entreprises accusent des pertes plus ou moins abyssales, certaines seront acculées au dépôt de bilan. Plus dramatique encore et surtout davantage contestable s’il se peut, toutes les personnes âgées résidant dans les EPHAD se sont retrouvées de facto séquestrées, les mourants sont partis dans une totale solitude sans croiser le regard d’un proche, d’un parent, et que dire enfin des désarrois psychiques, des états dépressifs induits par l’enfermement ? Les pertes des commerces et des entreprises peuvent être quantifiées, chiffrées ; les souffrances humaines ne peuvent pas l’être et ne pèseront pas, à cause de cela, pour grand-chose dans les discours publics et dans les décisions à venir.
C’est pourtant dans ces domaines que se trouvent les plus grands scandales, si révélateurs du degré de déshérence spirituelle dans lequel nous sommes tombés. J’évoquerai l’exemple de Bruno, dont le père était entre la vie et la mort bien avant le confinement, et se trouvait dans un établissement de soins. Ce père décède vers la fin du mois de mars :il n’est d’ailleurs pas interdit de penser que le papa s’est laissé mourir, n’ayant plus la visite de son épouse ni de ses enfants et petits-enfants … Faut-il préciser que Bruno n’aura pas eu le droit de visiter son père, de l’embrasser, de lui tenir la main, de lui parler. Au nom – soi-disant – de la santé publique, les gestes élémentaires d’humanité et de compassion sont devenus prohibés. Au nom de la vie biologique, avec comme critère un taux de mortalité de 0,08 %, l’humanité de la personne se retrouve éliminée…. Les prétentions de Léviathan entendent d’ailleurs, comme dans Antigone, régir l’au-delà de la mort : aucun temps de prière à l’intérieur de l’établissement ne sera autorisé et les funérailles, avec une assemblée réduite à une dizaine de personnes ne devront pas, en principe, excéder quelques dizaines de minutes … Evoquons encore une autre situation, celle de Marion. La santé de ses vieux parents, presque nonagénaires, s’est rapidement dégradée en mars dernier, rendant nécessaire une hospitalisation, puis un séjour en Service de soins et de rééducation. Toutes les visites y furent assujetties au bon vouloir du médecin du service, qui les interdit. De surcroît, il était impossible de remettre en mains propres effets personnels ou autres objets ; tout cela devait être déposé à l’accueil avant 16 h et en semaine seulement. Marion et ses frères ont ensuite trouvé une place en EPHAD pour leurs parents, et espéraient les rencontrer à cette occasion, mais la direction de cet établissement leur fit comprendre que ces derniers, venant d’une autre maison, seraient d’abord assujettis à une mise en quarantaine. Bref, Marion s’est vue interdire toute visite à ses vieux parents depuis trois mois. De telles situations ont dû se répéter des milliers de fois … mais ne désespérons pas, et ne croyons pas, en pensant à ces milliers de drames, qu’en notre beau pays de France le droit des familles soit malmené. Non : dans une décision du 7 août dernier, le Conseil Constitutionnel s’est opposé à ce que des mesures de sûreté soient appliquées à des auteurs d’action terroristes, au sortir de prison, car ces dernières porteraient atteintes « au droit de mener une vie familiale normale » ( § 15) Pour toutes ces familles ayant des parents âgés qui furent de facto séquestrés, une telle décision ne peut que choquer : certes, le droit est flexible, mais cela justifie-t-il des appréciations aussi contradictoires de situations humainement comparables ?
Nous avons vécu, et cela risque de perdurer encore, une situation stupéfiante dans laquelle notre quotidienneté ne fut qu’exceptionnellement affectée par une épidémie qui – redisons-le – est réelle et peut avoir des effets redoutables, alors que cette même quotidienneté s’est trouvée tourneboulée par des injonctions politiques et administratives prises au nom de la lutte contre ladite épidémie. Ainsi, j’ignore s’il y a un seul malade lorsque je fais mon marché, mais je dois déambuler au milieu d’une cohorte de martiens avec le même déguisement qu’eux. Au nom de ma santé, je ne puis plus travailler, ni aller écouter des cours, ni conduire mes enfants à l’école, ni me rendre au cinéma, au théâtre à l’Opera, à l’église. Au nom de ma santé, je suis sommé de vivre comme en résidence surveillée, au nom de ma santé je me dois de me contenter d’une vie étriquée, de me réduire à une sorte de monade hérissée de barrières et pour laquelle toute proximité d’une autre monade ne peut qu’être source de risques et de périls. Au nom de la lutte contre une calamité éventuelle, l’existence réelle est sommée de se caparaçonner dans l’uniforme d’une sorte d’immense hôpital.
Mais comment en sommes-nous arrivés là ? En France, la crainte qui servit de levier et conduisit au confinement général fut de voir les unités de soins intensifs dramatiquement insuffisants face à l’afflux des besoins. Crainte au demeurant respectable, crainte de gestionnaires : il s’agissait, au fond, de « gérer les flux » et d’éviter une cascade de procès émanant des familles auxquelles l’accès à ces soins aurait été refusé, faute de place. Mais la disproportion entre ces soucis de responsables de la santé et le quasi-enfermement d’une population entière reste patente et stupéfiante. Cette évidente disproportion, cette étonnante opération administrative et politique mise en place, au moins en théorie, dans le monde entier laisse perplexe. En effet, plus fortes sont les peurs, et plus les gains engrangés par des laboratoires inventeurs de vaccins seront substantiels. Plus les conséquences économiques seront dramatiques, plus il sera aisé de pérorer dans quelque temps, l’air grave, sur l’urgence de réduire les coûts salariaux. Manipulation de l’opinion à une échelle mondiale ? Je ne sais. L’opinion se manipule, évidemment, mais pas à partir de rien, mais en s’ancrant, pour les parasiter, sur des croyances, sur des illusions préexistantes. Et, sauf si l’on a la malchance de vivre au cœur d’un pouvoir totalitaire, l’acteur de ces manipulations ne peut être unique. Mais je laisse ces questions à des politologues, pour m’intéresser à ces croyances justement, à ces illusions rendant possibles une aberration comme celle en laquelle nous sommes englués.
Cet espèce de pouvoir tératologique auquel la population consent ou, du moins, contre lequel elle ne se rebelle pas, ressemble bien moins aux totalitarismes de type nazi ou soviétique qu’à ce que Tocqueville nommait, faute de mieux, un « despotisme » : l’érection d’un pouvoir tutélaire, absolu « qui ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance », un pouvoir qui, laissé à sa logique, « nous ôterait entièrement le trouble de penser et la peine de vivre pour reprendre des lignes célèbres de la Démocratie en Amérique. ». Si logique totalisante il y a dans l’espèce de despotisme actuel, elle ne procède pas d’une intention politique et gouvernementale. Elle est autrement prégnante, elle est idéologique, ancrée dans le schème fondateur de la mythologie moderne, ou post-moderne : l’homme est sur terre pour être heureux, la santé est l’ingrédient de base de ce bonheur, et « la » science, par les suites techniques qu’elle rend possibles et dont elle est désormais indissociable, offre le moyen de garantir à cette santé toute la place qui lui revient. Voilà, esquissée grosso modo, ce me semble, le cœur de l’imaginaire actuel. La santé tient lieu et place du salut dans la mesure où l’idée que notre vie puisse ne pas se limiter pas à l’existence présente est devenue exotique pour la plupart des hommes d’aujourd’hui.
Voilà pourquoi une menace globale portant sur notre santé, qu’elle soit réelle ou démesurément dramatisée, fera aisément entrer dans de la sacralité, avec en particulier la dichotomie du temps sacré et du temps profane. Le premier est, par définition temporaire, provisoire, marqué par des excès et des inversions de norme. C’est, au fond, l’imaginaire sollicité par notre chef d’Etat scandant « Nous sommes en guerre ! » A l’aune du raisonnable, une telle affirmation n’est qu’une billevesée. Mais, dans l’escarcelle de l’imaginaire – et c’est avec elle que l’on mène les peuples – elle n’est pas si mal vue : une guerre a toujours une fin. Les lois du temps profane y sont modifiées, voire suspendues, voire inversées. Ainsi l’obligation d’une présence scolaire se mue-t-elle en une interdiction, l’injonction de se rendre au travail est remplacée par celle de privilégier le télétravail depuis son domicile, l’interdiction d’avoir le visage masqué dans les espaces et lieux publics se mue en obligation de porter un masque etc…Et le moment fort, celui du triomphe sur cet absolu du mal qu’est la maladie adviendra avec la fabrication, par la conjonction de la Science et de la Technique toujours triomphantes, de quelque vaccin assurant vie et santé pour tous …et le retour à un temps profane d’agitation et de consommation !
Essayons d’aller encore un peu plus loin. La sacralisation de la santé et l’exorcisme symbolique de la mort qui en est le corollaire, sont au cœur des désinformations, des dramaturgies, des illusions sans lesquelles cette espèce de despotisme que nous venons d’évoquer ne pourrait prendre racine. Une telle sacralisation est déjà irrecevable dans une approche purement raisonnée, philosophique, comme nous allons le voir, et elle l’est a fortiori dans la foi chrétienne. Evoquons donc des sagesses antiques, qu’il s’agisse du platonisme, de l’aristotélisme, du stoïcisme : nous rencontrons une interrogation convergente sur ce que l’on nommait alors le souverain bien : que peut bien être un bien au-dessus des autres, un bien qui mérite d’être atteint pour lui-même et non en vue d’autre chose ? Cette investigation commune avait conduit à proposer comme une liste de l’ensemble de ce que les hommes considèrent, à tort ou à raison comme des biens. Et, dans cette nomenclature il était d’usage de distinguer les biens extérieurs et intérieurs. Sont extérieurs les biens qui ne qualifient pas ma pensée ou mon éthique et ne peuvent être garantis par ma seule volonté : la richesse, l’honneur, l’amitié, la santé par exemple. Aucune de ces données n’est, en elle-même méprisable, il est même possible d’affirmer que la richesse est préférable à la pauvreté, l’honneur au mépris, la santé à la maladie. Mais aucun de ces soi-disant biens ne peut être érigé en souverain bien. D’abord, ils ne dépendent pas de moi : guerres, maladies, désastres naturels peuvent me faire basculer de l’abondance à l’indigence. La versatilité de l’opinion peut, en quelques jours, faire plonger les grands de ce monde du pinacle du pouvoir à l’opprobre de la prison. L’accident, la maladie bouleversent en quelques heures une existence humaine etc. Voir dans ces biens apparents un bien suprême est un sûr moyen de s’assujettir, de consentir à devenir dépendant puisqu’aucune d’eux n’est en mon pouvoir. Leur désir peut même conduire à une servilité politique si j’imagine que le Pouvoir est à même de me garantir honneur, richesse ou … santé ! Surtout, le bien véritable de l’homme, enseigneront ces sagesses, ne peut se trouver qu’en lien avec ce qui lui est propre et le distingue des animaux : son aptitude à penser, à réfléchir. C’est avec la tempérance, avec la force d’âme, avec la sagesse que nous serons dans les terres des véritables biens. Epictète fera ainsi remarquer que la maladie ne m’empêche pas de demeurer ou de devenir un homme honnête …
Quant à la peur de la mort, ces mêmes philosophies ont su montrer la nécessité de l’apprivoiser. Chacun connaît l’aphorisme de Platon selon lequel « Philosopher, c’est apprendre à mourir », autrement dit la philosophie, en montrant la valeur singulière de l’esprit, de la pensée, nous accoutume à mettre cet esprit au-dessus du corps, à l’en séparer, en quelque sorte, ainsi qu’il adviendra à notre mort. Les stoïciens, ceux en particulier qui vécurent au sein de l’empire romain, au sein d’une organisation méthodique du pouvoir, posèrent même la crainte de la mort comme la source de tous les maux pour l’homme : en effet, le Pouvoir peut fort bien me mettre à mort et si je me laisse tétaniser par cette antipathique possibilité, je me love dans une attitude de consentement à la servilité : « As-tu bien dans l’esprit que le principe de tous les maux pour l’homme, de la bassesse, de la lâcheté, ce n’est pas la mort mais plutôt la crainte de la mort ? Exerce-toi contre elle ; qu’à cela tendent toutes tes paroles, tes études, tes lectures, et tu sauras que c’est le seul moyen pour les hommes de devenir libres. » (Entretiens III, 38-39) En des circonstances autres que celles auxquelles pensait Epictète, la sacralisation de la santé et la dramatisation de la mort auxquelles nous avons affaire aujourd’hui ont exactement les mêmes effets que ceux que cet auteur avait su mettre en lumière : elles nous prédisposent à un consentement, à une complaisance, à une servilité face à la pléthore d’interdits et d’injonctions mis en œuvre au nom de notre santé. Un imaginaire de la santé nous emprisonne. Savoir si cela est intentionnel ou non de la part des pouvoirs est, à la limite, une question seconde : il m’appartient de savoir comment j’entends vivre.
Pour nous, chrétiens, il va sans dire que la place de la mort, le sens de la condition humaine ont été radicalement transformés par la kénose de l’unique Dieu Trois fois Saint en la Personne du Christ. Et le Oui marial, en ouvrant et en offrant la collaboration de l’Humanité au plan divin, a radicalement modifié et notre sens et notre espérance. Il n’y a pas de foi chrétienne qui ne soit résurrectionnelle, l’unique événement central de toute l’histoire de l’humanité étant, pour un chrétien, l’attestation du Tombeau vide : l’affirmation angélique « Il est ressuscité ! » (Lc 24,6), le « J’ai vu le Seigneur » de sainte Marie-Madeleine. (Jn 20,18) Au matin de Pâques, la puissance de la mort a été vaincue, les verrous de l’enfer brisés : en cet aujourd’hui de Pâques, par Sa mort, le Christ triomphe de la mort, Il nous délivre du tombeau pour nous donner la Vie. Voilà le cœur de notre foi, de notre espérance, de notre joie. Il en résulte que notre mort est notre Pâques, notre passage vers « ce séjour de la Lumière, de la fraîcheur et de la paix, en un lieu d’où sont absents la tristesse, la peine et les gémissements. » (Office des funérailles). Notre foi n’abolit ni la crainte, ni même l’angoisse vécue, en son humanité, par le Fils de Dieu lui-même devant ce passage. (Lc 22, 44) De plus, notre foi ne transfigure pas seulement notre compréhension de la mort, elle modifie d’abord le cœur de l’existence présente pendant laquelle nous sommes appelés à vivre déjà en Christ, par le baptême, par la Divine Liturgie, par notre ascèse. Vivre et demeurer en Christ devient comme l’ancre, comme le roc de notre pèlerinage : nous vivons cela, du moins nous nous efforçons de le faire en étant dans ce monde mais sans être de ce monde. Nous n’éprouvons d’ailleurs aucun mépris, sauf à sombrer dans l’illusion d’un fol orgueil, pour les choses de ce monde, mais elles ne sont pas ultimes, elles ne peuvent qu’être avant-dernières. Les pouvoirs des hommes, auxquels nous devons obéir tant qu’ils ne nous condamnent pas à quelque apostasie, ne constituent pas l’Autorité ultime. Les valeurs de ce monde ne peuvent, au mieux, qu’être avant-dernières : la santé ne peut devenir un bien absolu, ni la maladie un mal absolu. S’il convient de ne pas pérorer devant un malade, comme le firent les « amis » de Job, s’il convient d’habiter le silence en présence d’une personne qui souffre, il ne s’ensuit pas nécessairement que toute maladie soit absurde. Nous pouvons, en notre for intérieur et pour notre gouverne personnelle, rester à l’écoute d’un saint Païssios (1924-1994) disant que les maladies lui furent plus utiles que toute l’ascèse monastique qu’il avait si assidument pratiquée ; nous pouvons entendre, dans le silence de notre âme, un saint Porphyre (1906-1991), ce familier de la souffrance, affirmer que ses maladies furent des visitations divines. Gardons-nous de faire un discours à la personne qui souffre, mais gardons-nous aussi, même si c’est de mode, d’identifier souffrance et non-sens : les saints aussi peuvent nous enseigner !
J’eus aimé entendre plus souvent quelque écho de ces certitudes de foi et de cœur, à mesure que les injonctions sur l’organisation et le déroulement des Liturgies et des Offices se faisaient davantage pressantes. Obéir, tant que cela est possible : oui. Il n’est pas nécessairement utile d’y ajouter je ne sais quel zèle quelque peu obséquieux ; une parole greffée sur « la Vérité qui nous rend libre » (Jn 8,32) accompagnerait et resituerait avec élégance cette inévitable subordination. La plus grave illusion serait de croire qu’une telle obéissance aux injonctions de masquer son visage et de respecter une distance dite sanitaire puisse être autre chose qu’une contrainte juridique, qu’elle puisse se muer en un bel exemple de civisme rendant les autorités, voire l’opinion, mieux disposées à l’égard des offices religieux. Imaginer que les mises en scène complaisantes de célébrants masqués pourrait peut-être atténuer la tension entre la foi chrétienne et le monde et constituerait une tragique erreur ! Dans notre foi, nous ne cherchons aucun conflit ! Mais c’est « Le Monde » qui ne veut et ne peut entendre la Parole de Vérité. Dans son intemporel aujourd’hui, le Christ nous dit qu’un tel conflit demeure inéluctable, car « le monde » ne veut et ne peut entendre la Parole de Vérité. Nulle tentation de servilité, nul imaginaire d’accommodement ne réduira ou ne diffèrera l’antagonisme entre le Christ et Bélial. Nous n’avons ni à provoquer cette confrontation spirituelle, ni à le désirer, nous avons seulement à prier pour n’avoir pas peur de nous déclarer pour le Christ devant les hommes, de crainte d’être reniés par Lui, le jour où ce conflit spirituel et cosmique advient. (Lc 12, 9). Nous avons à prier pour que l’Esprit-Saint vienne et demeure alors en nous, qu’Il nous donne de vivre en hommes libérés de toutes les idolâtries, de tous les emprisonnements spirituels. Notre foi dans le Ressuscité ne nous rend pas irresponsables, elle ne nous fournit pas un brevet de désinvolture mais elle nous délivre de la peur de la mort et, à plus forte raison de la manipulation méthodique et quelque peu totalitaire de cette peur. « N’ayez pas peur ! » cette injonction libératrice, dite des centaines de fois dans la Bible, nous devons hic et nunc la vivre et la transmettre, à temps et contretemps.
Jean Gobert
Vous souhaitez être informé lors de la publication d'une nouvelle Chronique du Pèlerin ?
Laissez-nous votre adresse mail.
Les opinions exprimées dans cette page sont le fait de leur auteur et ne peuvent être imputées au monastère de la Transfiguration.